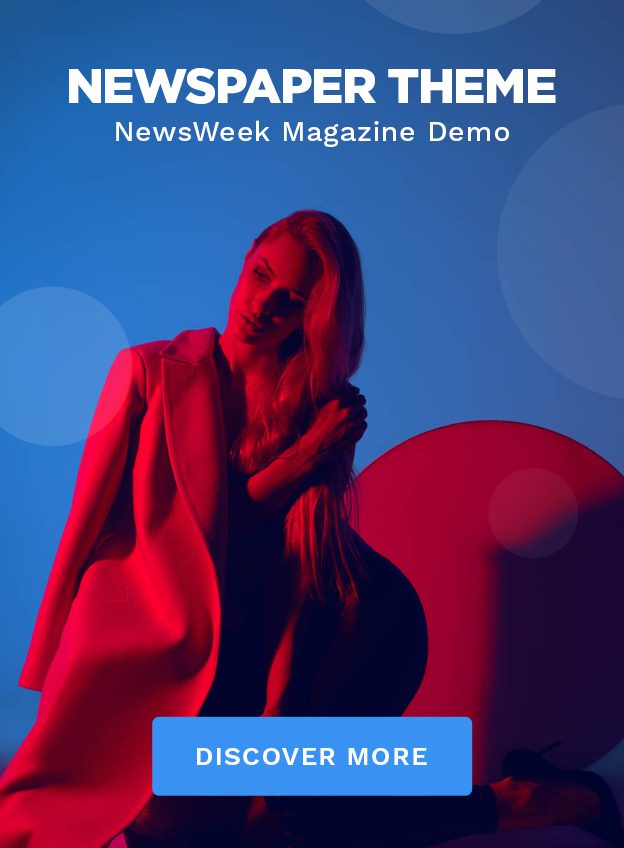Il fallait s’y attendre : à chaque fois qu’un débat crucial sur l’identité nationale s’ouvre, une partie des élites politiques françaises se précipite pour en refermer la porte, la peur au ventre et la bouche pleine de bons sentiments. François Bayrou, chantre du centrisme brumeux, vient d’en donner une nouvelle preuve éclatante. Après avoir soutenu l’interdiction du voile dans les compétitions sportives officielles — mesure adoptée au Sénat — le voilà qui recule, freinant des deux pieds lorsqu’il s’agit de faire voter la loi à l’Assemblée nationale. Pourquoi ? Parce que, dit-il, il ne faudrait pas « stigmatiser nos compatriotes musulmans ». Le grand refrain de l’évitement recommence. On connaît la chanson : on évite, on contourne, on ajourne… et pendant ce temps, l’adversaire avance.
On ne gagne pas une guerre idéologique en posant des jalons de reddition.
Le voile, ici, n’est pas une simple affaire vestimentaire. Il est un marqueur, un outil d’entrisme, un acte militant au service d’un projet global : l’islamisation des espaces publics, même ceux qui devraient en être les sanctuaires — les terrains de sport, lieux de neutralité et de communion républicaine. En reculant, Bayrou ne cherche pas à éviter un affrontement, il accepte de facto un changement de règles du jeu. À chaque renoncement s’ajoute un clou au cercueil de la laïcité.
Ce n’est pas la première fois que l’ancien ministre de l’Éducation Nationale choisit le flou plutôt que la clarté, l’ambiguïté plutôt que le courage. Déjà, à l’époque des foulards de Creil, il hésitait. Lors de la loi de 2004 interdisant les signes religieux à l’école, il s’abstient. Et depuis, c’est une ligne continue de gestes tièdes, d’empathie mal placée et d’atermoiements qui tiennent davantage du déni que de la nuance.
Quand la prudence devient systématique, elle cesse d’être une vertu et devient un renoncement.
Ce qui frappe chez Bayrou, ce n’est pas tant l’opportunisme — il en est friand depuis toujours — que l’idéologie rampante qu’il véhicule sans la nommer. Une idéologie de la résignation douce, nourrie de culpabilité chrétienne mal digérée et d’un fantasme de réconciliation universelle. Il croit, ou feint de croire, que le communautarisme islamique peut être apprivoisé par la bienveillance et la reconnaissance. Qu’il suffirait de tendre la main pour qu’un islam politique, fondé sur la conquête des esprits et des espaces, se dissolve dans la République. Illusion tragique.
Cette posture est d’autant plus grave qu’elle survient dans un contexte où les signaux de l’entrisme islamiste se multiplient. Sur les réseaux sociaux, dans les stades, dans les universités, dans certaines mairies : la contestation des normes républicaines progresse, sous couvert de diversité culturelle. Chaque recul législatif est un boulevard ouvert pour ces assauts. Et pendant que certains s’inquiètent de « stigmatiser », les militants islamistes, eux, n’ont aucune pudeur à imposer leur agenda.
La République ne peut pas être laïque à mi-temps. Elle ne peut pas exiger la neutralité dans l’école et la refuser dans les terrains de sport. Elle ne peut pas affirmer l’universalité tout en autorisant des symboles qui divisent. Une compétition officielle est une scène de représentation nationale. Y laisser s’exprimer des revendications identitaires, c’est trahir l’idée même de la citoyenneté.
À force de reculer devant ceux qui avancent, il ne restera bientôt plus rien à défendre.
Mais Bayrou ne veut pas de heurts. Il veut la paix sociale au prix de la vérité, l’harmonie factice au prix de l’autorité. Ce faux équilibre est celui des régimes faibles, qui substituent à la clarté des principes le bavardage compassionnel. L’Histoire jugera sévèrement ceux qui, au nom de l’apaisement, auront préféré la capitulation préventive. Il ne s’agissait pas d’exclure, mais de rappeler que l’espace public, dans ses formes les plus visibles comme le sport, doit demeurer l’expression d’une culture commune. Ce n’est pas le voile qu’il fallait interdire. C’était l’habitude de s’excuser d’exister.