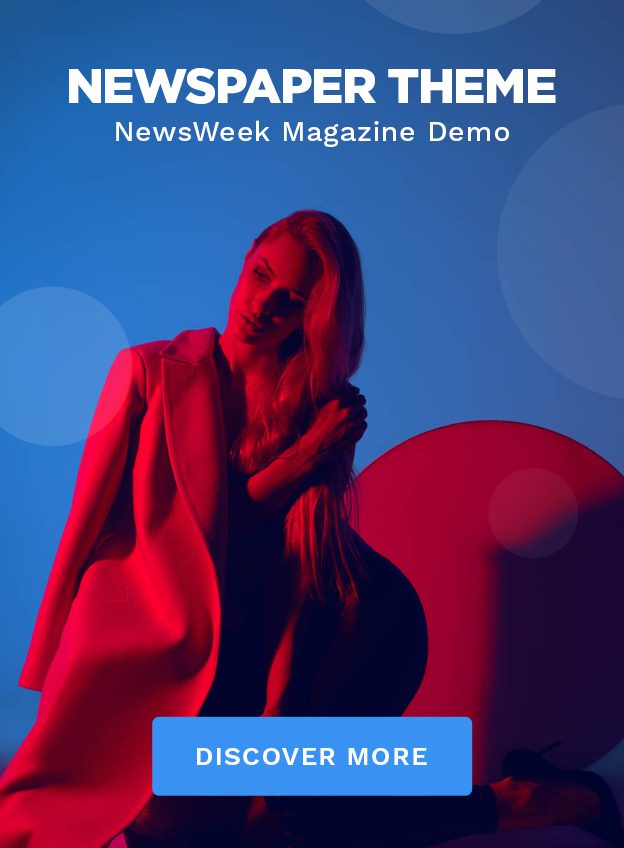Il paraît qu’on reconnaît un empire à la taille de son déficit commercial et à la longueur de ses sermons protectionnistes. Si c’est vrai, alors Donald Trump n’est pas le président des États-Unis, mais une réincarnation tardive de Néron, prêt à mettre le feu à la mondialisation tout en jouant du tweet comme d’une lyre. Ce qui devait être, selon lui, un jour de libération pour l’Amérique — celle où l’on reprendrait le contrôle de ses frontières économiques — ressemble surtout à une veillée d’armes mondialisée, un couvre-feu pour marchés tremblants.
Quand Trump parle de libération, les bourses parlent de dépression.
Le suspense est insoutenable : va-t-on vers une taxe unilatérale qui vise large, ou un jeu de miroirs douaniers contre les ennemis désignés du moment — c’est-à-dire tous ceux qui ne disent pas « Yes, Mr President » avec assez d’enthousiasme ? Le monde, pendu aux lèvres d’un homme qui croit que « tariff » est un synonyme de « justice divine », retient son souffle et son portefeuille. Les marchés boursiers, eux, ont déjà voté : ils fuient comme des actionnaires face à une conférence de presse d’Elon Musk sobre.
Dieu, l’amour, la religion… et les droits de douane : les quatre cavaliers de l’économie trumpienne.
L’Europe, brave et fidèle partenaire de l’OTAN, se retrouve dans la ligne de mire. Non pas parce qu’elle a trahi, mais parce qu’elle existe. À Bruxelles, on se raidit comme une statue de Marianne sous anxiolytiques. Ursula von der Leyen dégaine les grands mots : « plan solide », « réplique immédiate », « pas de faiblesse ». Mais derrière le rideau martial, on entend déjà les cartons de gaz liquéfié en provenance du Texas, les contrats d’armement griffonnés à la hâte, et les règlements antitrust discrètement remisés au fond d’un tiroir.
La guerre commerciale version Trump, c’est l’art de se jeter dans la mêlée en assurant qu’on veut la paix. Il annonce qu’il sera « gentil », puis traite l’Amérique de tirelire braquée par ses partenaires. Une générosité typiquement mafieuse : le racket avec le sourire. Et l’Europe, à force de se vouloir stratégique, finit par jouer au paillasson tactique.
L’Europe parle comme de Gaulle et négocie comme un stagiaire chez Gazprom.
Mais tout n’est pas perdu. Christine Lagarde, en prêtresse monétaire, bénit la guerre comme un « moment existentiel ». Un genre de baptême du feu, sauf que cette fois, c’est la facture qui brûle. Il ne manque plus qu’elle cite Nietzsche ou le marquis de Sade, et l’on aurait un parfait sermon sur le salut par la douleur économique. L’Europe, donc, pauvre, seule et fière. Une sorte de Don Quichotte fiscal, lancé à l’assaut des moulins à dollars, mais avec une dette commune et des prévisions de croissance en guise de destrier.
Pendant ce temps, les États-Unis ajustent leurs lunettes à double foyer : un œil sur la Chine, l’autre sur l’Allemagne, et l’index sur le bouton « TAXE ». Que l’Europe proteste ou applaude n’a finalement qu’un intérêt folklorique. Elle est déjà à vendre, ou à louer, selon les conditions.