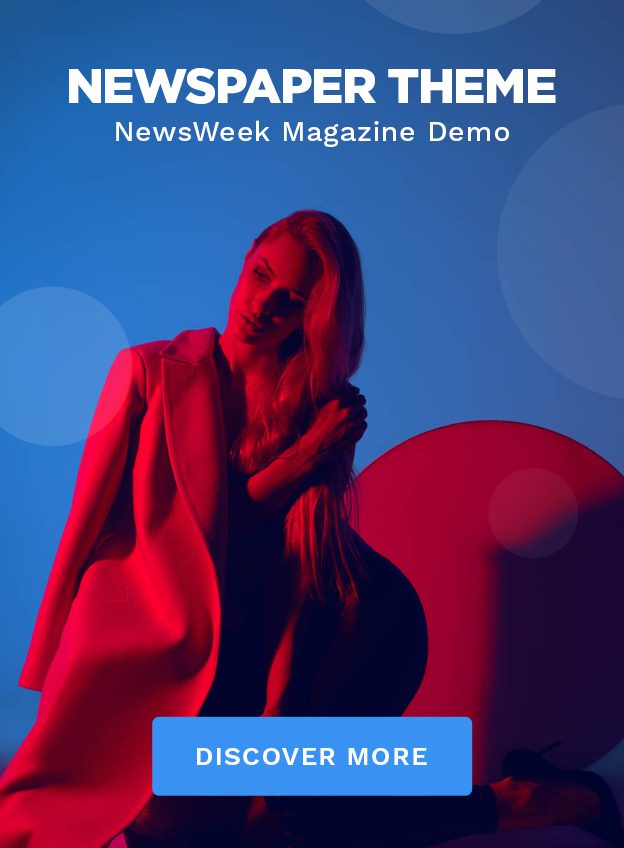Le moment est grave. Mais il ne surprendra que ceux qui, dans leur candeur ou leur paresse, refusent de voir ce que ce pays devient. Car ce n’est pas seulement Marine Le Pen qui est visée par l’exécution provisoire d’une peine d’inéligibilité. Ce n’est pas seulement la candidate que l’on cherche à empêcher. C’est l’électeur que l’on veut disqualifier. C’est le peuple que l’on soupçonne d’avoir de mauvais penchants, qu’il faut contenir, contrôler, corriger. Alors on dégaine les outils d’une justice plus militante que neutre, plus zélée que prudente, plus politique que judiciaire.
On aurait pu croire que le principe de la présomption d’innocence, pourtant brandi à tout bout de champ lorsqu’il s’agit de délinquants de droit commun, bénéficierait aussi à une opposante politique. Mais non : voici que l’on applique une exécution provisoire, ce mécanisme exceptionnel qui devrait n’être qu’exceptionnellement utilisé. Et pourquoi ? Parce que, dit-on, un trouble à l’ordre public serait à craindre si une candidate condamnée en première instance pouvait continuer à prétendre aux plus hautes fonctions. Il ne s’agit plus d’appliquer la loi. Il s’agit de prévenir une hypothétique insubordination démocratique. Il s’agit d’éteindre à la source la tentation populaire.
L’inaction face aux dérives idéologiques n’est plus une option, mais une complicité.
Qu’une juge ose justifier sa décision par la nécessité d’éviter qu’une candidate qu’elle a condamnée puisse se représenter est une monstruosité républicaine. Car c’est une chose de juger une infraction, c’en est une autre de se mêler du choix des électeurs. Or nous y sommes. Que la loi le permette est une chose. Mais qu’elle soit ainsi interprétée contre l’esprit même du droit de recours, contre le principe d’équité, contre le respect du suffrage universel, en est une autre. Car le droit est ici utilisé comme un levier politique, et les juges comme des agents du pouvoir moralisateur.
Certains esprits, plus confiants ou plus naïfs, objecteront que la décision est conforme à la loi. Qu’après tout, il ne s’agit que de l’application stricte d’un texte. Mais la loi, chacun le sait, n’est jamais qu’un prétexte entre des mains idéologiquement trempées. Il ne s’agit pas ici de justice, il s’agit de disqualification. Il ne s’agit pas d’appliquer une norme, mais de redessiner la carte du jeu politique. À coups de condamnations provisoires. À coups d’inéligibilités préventives. À coups de prétextes moraux.
Quand les juges deviennent des censeurs, la démocratie devient un décor.
Élisabeth Lévy a raison de dénoncer une République des juges. Une république où l’on ne tranche plus entre le bien et le mal, mais entre les bons et les mauvais électeurs. Une république où le droit devient l’arme du progrès obligé, où l’on punit non plus des actes mais des intentions. Le crime de Marine Le Pen ? Ne pas avoir reconnu sa faute. Pire encore : la contester. Dans ce pays, il est devenu dangereux de se défendre. Car se défendre, c’est récidiver. Et récidiver, c’est confirmer sa culpabilité. Dès lors, toute contestation devient insupportable. On ne cherche pas seulement à condamner, on exige des aveux. Et si possible, la repentance.
Cette affaire révèle une chose simple : l’extrême sélectivité de notre système judiciaire. Il est lent, complaisant ou aveugle pour les violences urbaines, les harcèlements communautaristes, les fraudes idéologiques. Mais il devient véloce, impitoyable et théâtral lorsqu’il s’agit de délits financiers supposés, surtout s’ils sont commis par une figure honnie du système. Rappelons tout de même que le parquet lui-même a admis l’absence d’enrichissement personnel dans cette affaire. Mais peu importe : la cible est symbolique. Elle incarne l’ennemi à abattre. Ce n’est pas une décision judiciaire, c’est une mise en scène sacrificielle.
Déposséder le peuple de son droit de choisir, c’est déjà le condamner à n’être qu’un figurant.
Ce n’est donc pas Marine Le Pen qui est seule en cause. Ce sont tous ceux qui pourraient demain déplaire au pouvoir moral dominant. Tous ceux dont l’ambition électorale pourrait heurter la bien-pensance institutionnelle. Tous ceux qui contestent l’ordre établi et qui refusent de bêler avec le troupeau. L’exécution immédiate de l’inéligibilité devient alors le glaive que brandit un pouvoir judiciaire transformé en bras armé de la morale publique.
Il faut le dire : une démocratie où les juges décident de qui peut se présenter est une démocratie malade. Une démocratie en sursis. Une démocratie dévitalisée. Car si les recours existent, c’est bien parce qu’une condamnation en première instance n’est jamais définitive. En faire l’équivalent d’un jugement final, c’est abolir le droit à l’erreur judiciaire. C’est nier la hiérarchie des juridictions. Et surtout, c’est décider que le peuple ne saura pas attendre. Qu’il est trop bête pour comprendre. Trop fragile pour choisir.
Il ne s’agit pas de défendre une femme politique. Il s’agit de défendre une idée. Celle de la souveraineté populaire. Celle selon laquelle seul le peuple, et non les juges, doit décider qui est digne de le représenter. Empêcher une candidature, c’est usurper ce pouvoir. C’est nier l’article premier de toute République digne de ce nom : que la souveraineté appartient au peuple.
Il y a, dans cette affaire, un relent de vieille Europe autoritaire. Celle des pouvoirs qui n’aiment pas le vote. Celle qui redoute le choix du peuple comme on redoute une maladie. Mais à force de priver les électeurs de leurs candidats, c’est leur colère qu’on amplifie. C’est leur légitimité qu’on renforce. Et c’est la nôtre que l’on érode. L’avenir dira si cette manœuvre judiciaire se transformera en victoire démocratique. Mais l’Histoire, elle, n’a jamais été tendre avec ceux qui auront confondu la loi avec leur propre peur.