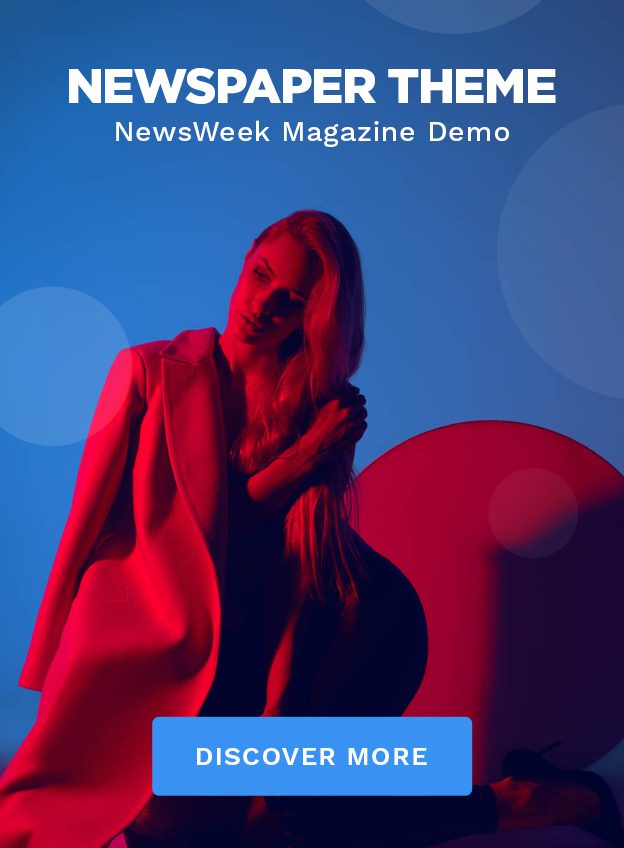C’est une scène à laquelle la France s’est hélas trop accoutumée. Le représentant de la République, en mission d’apaisement, débarque à Alger avec des sourires crispés, des formules creuses et des espoirs douchés d’avance. Jean-Noël Barrot, envoyé spécial d’un exécutif en perte de repères, n’a pas redéfini les relations franco-algériennes. Il les a rejouées. Encore. Avec la même mise en scène, les mêmes silences gênés et les mêmes phrases à usage diplomatique unique, destinées à n’être ni entendues, ni suivies. C’est une scène à laquelle la France s’est hélas trop accoutumée.
Quand un pays croit apaiser ses fantômes en sacrifiant son autorité, il finit par devenir l’ombre de lui-même.
Car au théâtre des illusions bilatérales, Paris joue désormais sans texte, mais toujours avec un nœud papillon de plus en plus serré autour de la gorge. La rhétorique officielle parlait de « renforcer les passerelles », de « dialogue franc et constructif », et de « vision commune tournée vers l’avenir ». Des incantations que l’on pourrait imprimer sur un rouleau de papier peint diplomatique, tant elles sont interchangeables. Le langage est devenu un substitut de pensée, une parure pour masquer le vide sidéral d’une politique étrangère incapable d’assumer la moindre exigence.
Mais la vérité ne se maquille pas. Elle s’expose dans les images, comme celle de la réception du ministre français : posture soumise, regard hésitant, attitude réservée face à un interlocuteur algérien sûr de sa force. Le tableau n’est pas celui d’une rencontre d’égaux mais d’une leçon de maintien imposée par l’élève au professeur. Et ce n’est pas un incident, c’est une méthode. L’Algérie ne cède rien, n’ouvre rien, ne négocie rien. Elle impose. Et la France consent. Mais la vérité ne se maquille pas.
Quand l’image d’un échange diplomatique révèle un rapport de domination, ce n’est plus un malentendu, c’est une soumission institutionnalisée.
Sur le plan des faits, tout est dit dans l’absence de tout changement : l’accord migratoire de 1968 reste intouchable, les visas continuent d’être distribués sans contrepartie, et les expulsions ? Elles dépendent toujours du bon vouloir d’un consulat qui, très souvent, oppose des refus polis mais définitifs. La coopération se résume à une procédure aussi opaque qu’inefficace, où chaque préfet français doit désormais prier pour que l’Algérie accepte de récupérer les siens.
L’exemple le plus saisissant n’est même pas dans les refus administratifs, mais dans la passivité française face à ses propres humiliations. Alors que des individus prônant la violence contre nos institutions peuvent être expulsés dans l’urgence, ces mêmes mesures se heurtent à un mur quand l’Algérie refuse de reprendre ses ressortissants. Deux poids, deux diplomaties.
Et au cœur de ce théâtre d’ombres, un nom surgit : celui de Boualem Sansal. L’intellectuel, persécuté, reste détenu tandis que le ministre français repart les bras ballants, si ce n’est avec un vague « espoir d’un geste ». Aucun progrès, aucune fermeté, juste une supplique murmurée à la fin d’un entretien. Pendant ce temps, Alger parade, sûre de son impunité. Pourquoi céderait-elle ? Elle gagne sur tous les tableaux : image renforcée, concessions obtenues, et aucune exigence en retour.
Quand un pays en vient à implorer une faveur humanitaire sans exiger justice, il signe lui-même l’acte de décès de sa crédibilité.
Il faut appeler les choses par leur nom : cette politique étrangère n’est pas une stratégie, c’est une capitulation permanente. Les discours prétendument équilibrés masquent mal une perte de repères gravissime. L’Algérie est désormais un partenaire qui exige, un allié qui gronde, un voisin qui domine, et la France, un État qui attend, qui doute, qui recule. Ce n’est plus de la prudence, c’est de l’abdication.
Le naufrage est d’autant plus inquiétant qu’il s’inscrit dans un contexte plus large : celui d’une diplomatie française qui, à force de vouloir plaire à tout le monde, ne plaît plus à personne. À force de ménager les susceptibilités algériennes, on a sacrifié les intérêts français. Et à force de relativiser les faits, on a perdu le sens du réel.