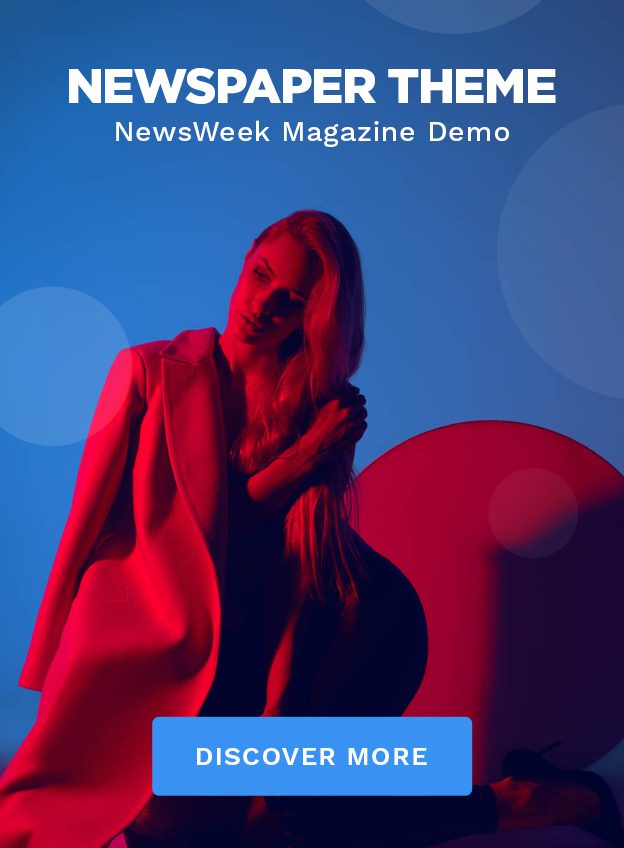La loi veut plus de femmes en politique ? Très bien. Mais à quel prix ? Dans les petites communes françaises, cette nouvelle contrainte risque de vider les urnes bien plus que de remplir les bancs municipaux. Sous l’apparence d’un progrès, la parité devient un filtre impitoyable : mieux vaut ne pas voter que voter imparfait. Ainsi meurt la démocratie, non par excès de machisme, mais par overdose de normes.
«Le tact dans l’audace, c’est de savoir jusqu’où on peut aller trop loin. » Cette formule de Jean Cocteau pourrait servir d’épigraphe à cette nouvelle injonction législative imposée aux communes rurales. En étendant le dispositif de la parité aux villages de moins de 1 000 habitants, la République confirme son appétit normatif, sa volonté de tout régir, jusqu’aux recoins les plus modestes de la représentation politique. Derrière les grands mots — égalité, justice, diversité —, on assiste à l’irruption d’un formalisme abstrait dans des territoires où le simple fait de constituer une liste électorale relève souvent de l’exploit. La politique, jadis enracinée dans le réel et le bon sens local, se trouve chaque jour un peu plus reléguée au rang de théâtre réglementaire.
La parité imposée ressemble moins à une réparation qu’à une mise en conformité bureaucratique du vivant.
Car enfin, de quoi parle-t-on ? De villages de quelques centaines d’âmes, où le maire est à la fois cantonnier, médiateur, conseiller et confident. Où la fonction repose moins sur un programme politique que sur la confiance, la connaissance du terrain, l’engagement désintéressé. Là, imposer une alternance stricte entre hommes et femmes sur les listes électorales revient à calquer un modèle urbain, abstraction métropolitaine, sur un monde qui lui est profondément étranger. C’est là le grand malentendu de notre temps : faire comme si les réalités étaient interchangeables, comme si l’universalisme égalitaire pouvait ignorer les géographies humaines.
Ce qui est présenté comme un progrès par la présidente de l’Assemblée nationale est perçu par nombre d’élus comme une contrainte de plus, un empiètement supplémentaire sur leur liberté d’organisation. Loin de favoriser la démocratie, cette mesure pourrait l’étouffer. Faute de pouvoir constituer des listes conformes, certaines communes risquent de se retrouver sans candidats. Le comble d’une loi censée promouvoir la participation citoyenne : en tarir la source. La fabrique législative tourne à vide, incapable de penser la diversité des formes d’engagement politique.
quand le politique oublie qu’il est une incarnation, il devient un automate de l’idéologie.
Le fond du problème n’est pas tant la place des femmes en politique que le choix des instruments. La parité, lorsqu’elle devient une fin en soi, confine à l’obsession comptable. Le mérite et la compétence cèdent le pas à la conformité statistique. Or, l’égalité véritable n’est pas celle qui se mesure à la règle, mais celle qui permet à chacun d’accéder librement aux responsabilités. Les grandes figures féminines de la politique européenne — Margaret Thatcher, Angela Merkel ou Giorgia Meloni — ne doivent rien à un quelconque quota. Elles se sont imposées par la force de leur caractère et la qualité de leur vision. Dans nombre de pays qui n’imposent pas la parité, les femmes accèdent pourtant aux plus hautes fonctions : signe que ce n’est pas la loi, mais la culture politique qui change les choses.
Cette mécanique normative révèle en creux une méfiance envers les citoyens. Comme si ceux-ci étaient trop ignorants ou trop machistes pour choisir librement leurs représentants. La République ne fait plus confiance à ses enfants, elle préfère les encadrer, les corriger, les redresser. On parle d’émancipation, mais on produit de la défiance. On invoque la diversité, mais on homogénéise les procédures. C’est là une forme de centralisme moral : Paris dicte aux campagnes la forme que doit prendre leur représentation, au mépris de leurs contraintes, de leurs ressources, de leurs usages.
Le paradoxe est cruel : alors que les petites communes souffrent d’un manque chronique de vocations, alors que le mandat local est de plus en plus déserté — par lassitude, par découragement, parfois par désespoir —, l’État ajoute des contraintes. Une part significative de maires envisage de ne pas se représenter. Non pas parce qu’ils seraient dépassés par le féminisme de leur époque, mais parce qu’ils sont submergés par l’absurdité bureaucratique, par le sentiment d’être à la fois responsables de tout et maîtres de rien. Le problème n’est pas le sexe des élus, mais le poids de la charge qu’ils portent, souvent seuls, dans l’indifférence des sphères parisiennes.
Ce n’est pas de féminisation du pouvoir dont les élus ont besoin, mais de libération de leur action.
Il est toujours tentant de croire que l’égalité se décrète. C’est le réflexe d’une société qui a perdu foi dans les élans spontanés, dans la force du lien local, dans les vertus du mérite. Mais en remplaçant le désir par la norme, l’aspiration par l’obligation, on assèche l’engagement. La parité imposée dans les plus petites communes françaises n’est pas seulement une maladresse logistique, c’est un symptôme : celui d’une société qui confond le progrès avec l’alignement, l’émancipation avec la conformité.
Au fond, la vraie question est la suivante : jusqu’où l’État doit-il aller pour « égaliser » la société ? Et surtout, au prix de quoi ? L’uniformité imposée est-elle compatible avec la vitalité démocratique ? La liberté peut-elle subsister là où chaque geste politique devient l’exécution d’un protocole idéologique ? À force de vouloir faire le bien contre les réalités, on risque de ne produire que du vide.