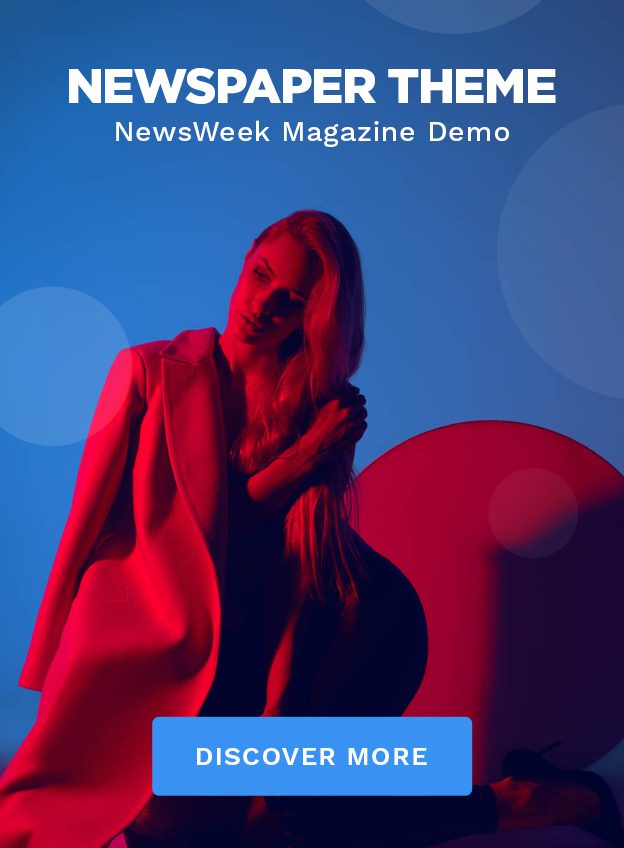L’heure n’est plus aux illusions. Quand la balance de la justice penche plus du côté du dogme que du droit, ce n’est plus d’un État de droit qu’il s’agit, mais d’un État d’exception politique permanent. La récente décision de priver une candidate d’un droit fondamental — se présenter au suffrage des citoyens — sans attendre l’épuisement des recours, n’est pas seulement une bizarrerie procédurale. C’est un coup porté au cœur même de la démocratie représentative. Non pas une simple mise à l’écart judiciaire, mais une disqualification morale prononcée par ceux qui, dans l’ombre des tribunaux, s’arrogent désormais le monopole de la vertu.
Quand la justice devient un outil de tri électoral, elle cesse d’être impartiale pour devenir partisane.
La prétendue neutralité judiciaire se transforme en un filtre idéologique. L’argument avancé, grotesque si l’on ose encore le dire, évoque un supposé trouble à l’ordre public si la candidate en question poursuivait sa course présidentielle. En somme, la seule perspective d’un vote mal orienté serait, aux yeux de certains, une menace suffisante pour suspendre les règles fondamentales du droit au recours. À ce compte, il ne reste plus grand-chose de la souveraineté populaire, sinon son souvenir moqué. La démocratie est ici soumise à une clause de moralité définie par ceux-là mêmes que le suffrage n’a jamais élus.
Qu’un citoyen soit jugé, cela va de soi. Qu’un opposant politique soit neutralisé, cela ne va pas du tout. Derrière le vernis juridique, c’est bien une logique inquisitoriale qui s’installe. Le droit devient à géométrie variable, appliqué avec une rigueur féroce aux uns, une indulgence complice aux autres. On parle ici d’une exécution provisoire prononcée dans une affaire où l’enrichissement personnel est absent, où la complexité des faits méritait au moins d’être débattue dans l’intégralité de la procédure. Mais non, l’essentiel n’est pas là : il fallait frapper vite, frapper fort, frapper avant que le peuple ne puisse trancher.
Empêcher le vote, c’est dicter sa volonté en robe noire là où seul le bulletin bleu, blanc, rouge devrait parler.
Le pouvoir judiciaire, lorsqu’il outrepasse sa fonction, devient une caricature de ce qu’il prétend défendre. L’équité cède la place à la mission. Les juges ne sont plus des arbitres, mais des acteurs de la grande lutte morale contre ceux qu’ils considèrent comme les hérétiques du régime républicain. Car n’en doutons pas : cette précipitation dans l’exécution d’une inéligibilité n’a rien d’un souci de justice. Elle est un message. Une démonstration de force. Une manière d’indiquer que certaines ambitions ne seront pas tolérées, que certains discours ne seront pas admis, que certains candidats ne seront pas autorisés.
Le pire n’est pas la décision. Le pire est le silence, voire l’acquiescement. Ceux qui autrefois s’égosillaient pour défendre le moindre droit d’appel pour des multirécidivistes, ne trouvent soudain plus rien à redire à cette brutalité procédurale. Ceux qui clament leur amour de la République acceptent qu’on la confisque sous prétexte de la protéger. Ceux qui s’indignent d’un tweet déplacé s’accommodent qu’on disqualifie une opposante par voie judiciaire avant même que sa culpabilité ne soit confirmée. Hypocrisie ? Cynisme ? Les deux, sans doute. Mais avant tout, une peur panique de voir les électeurs choisir hors du menu imposé.
Le juge n’est plus la bouche de la loi, mais le ventriloque d’une idéologie qui ne supporte plus la contradiction.
Car c’est bien cela le fond du problème : la démocratie réelle effraie. L’idée que le peuple puisse élire celui ou celle qui ne partage pas les dogmes officiels provoque des sueurs froides dans les salons où l’on aime tant parler du vivre-ensemble… entre soi. Alors, on redessine les règles. On n’interdit pas formellement. On “applique la loi” avec zèle. On active les leviers procéduraux, on décrète l’urgence, on soupçonne d’intentions malveillantes, et l’on prétend que le danger est trop grand pour attendre un appel. Le droit devient prétexte, la morale devient arme, et la justice se fait censeur.
On aurait pu croire que la leçon américaine aurait porté. Qu’on aurait compris qu’un peuple frustré d’expression finit toujours par se radicaliser, non par idéologie mais par simple exaspération. Mais non. On préfère provoquer l’humiliation, administrer la leçon, humilier l’électorat supposé fautif en lui ôtant la possibilité de choisir. Ce n’est plus le tribunal du droit, c’est le tribunal de la vertu. Ce n’est plus une république, c’est une théocratie morale, où le péché d’opinion vaut excommunication civique.
Rira bien qui rira le dernier ? Peut-être. Mais rien n’est moins sûr. Car une justice qui punit avant de juger, un système qui disqualifie avant d’entendre, un pouvoir qui choisit à la place du peuple — tout cela ne mène jamais à la paix. Cela mène au ressentiment, à la défiance, à l’explosion. Ce jour-là, les gardiens de la morale feindront de s’étonner. Ils joueront les vierges effarouchées, tout en cherchant un nouveau bouc émissaire. Et le peuple, une fois encore, ne sera ni écouté ni respecté, seulement surveillé.